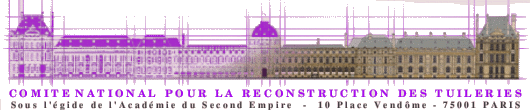
Le palais des Tuileries
à la fin du Second Empire
Description générale du palais
Un an avant le tragique incendie du 23 mai 1871, le Palais, résidence des souverains, siège du Gouvernement, était encore l'objet de travaux d'embellissement et d'agrandissement. Le Grand Dessein s'était réalisé en 1857 avec l'achèvement du Nouveau Louvre et un projet de rénovation des Tuileries élaboré par Lefuel avait débuté entre 1861 et 1865. La première tranche était la reconstruction de la galerie du Bord de l'Eau et du pavillon de Flore ainsi que la construction de la Salle des Etats (ces parties épargnées par l'incendie de 1871 sont toujours en place de nos jours).
Le palais était séparé du Louvre par une grande place desservie par les guichets de Rohan côté Nord et les guichets de Lesdiguières (appelés aussi du Carrousel) au sud, côté Seine. Cette place du Carrousel était un peu plus grande qu'aujourd'hui car elle se déployait jusqu'au pied de l'Arc de Triomphe du Carrousel.
Celui ci marquait l'entrée de la Cour du Carrousel qui desservait le Palais. Une splendide grille clôturait la Cour de part et d'autre de l'arc de triomphe et rejoignait les deux ailes du palais adjacentes à la rue de Rivoli et quai du Tuileries. Cette grille, reposant sur un petit muret d'environ 80 cm, était soutenue par des colonnes de marbre surmontées d'un globe et d'une flèche dorés. Si l'Arc de Triomphe était l'entrée principale de la Cour, deux autres entrées latérales de part et d'autre la desservaient. Ces entrées étaient constituées chacune de deux socles en pierre surmontés de statues. (Deux de ces quatre statues sont encore visibles de nos jours : la France victorieuse et l?Histoire.)
Le Palais se constituait d'un corps principal (aujourd'hui disparu) composé en son centre du Pavillon Central surmonté d'un dôme quadrangulaire. De part et d'autre de ce pavillon, une suite de bâtiments était composée d?une aile suivie d?un pavillon et d?une autre aile qui se raccordait à un pavillon d?angle (Flore et Marsan). En retour vers l'Est s?élançaient deux ailes de dépendances avec au nord, l'Aile Napoléon (longeant la rue de Rivoli et visible de nos jours) et au sud, l'Aile du Bord de l'Eau (longeant le quai des Tuileries et toujours intacte). Au bout de ces ailes, les jonctions avec le Louvre se faisaient par les pavillons abritants les guichets.
Description des intérieurs du corps principal des Tuileries
Le Pavillon Central où l'on accède côté cour par un portail rectangulaire ouvrait sur un vestibule péristyle de plein pied avec la cour. Du côté jardin, on y accédait par un portail en plein cintre desservi par quelques marches depuis le parterre du fait d?une différence de niveau entre le jardin des Tuileries et la Cour du Palais. Les premier et second étages du pavillon étaient occupés par la monumentale Salle des Maréchaux, grande salle de réception du Palais qui pouvait accueillir 600 invités.
La partie méridionale du corps central abritait côté cour au premier étage, les grands appartements avec à partir du centre : le Salon du Premier Consul servant d'antichambre, le salon d'Apollon, la salle du Trône, le salon Louis XIV salle à manger officielle puis la galerie de Diane qui rejoignait le pavillon de Flore.
Côté jardin, à partir de la salle des Maréchaux, l'escalier de l'Impératrice desservait au premier étage, les appartements de l'Impératrice constitués d'un salon d'huissiers, du salon Vert pour les dames d'honneur, du salon Rose ou salon d'attente, du salon Bleu ou salle d'audience, du cabinet de l'Impératrice suivi d'un boudoir. Ensuite il y avait les salles privées de l'Impératrice : salle de bains, cabinet de toilette, chambre à coucher et salon privé. Ensuite l?enfilade continuait avec l'appartement du Prince impérial constitué d'un cabinet, d'une chambre et d'un salon suivi par l'escalier de l'habitation adjacent au pavillon de Flore. Cet appartement n?était que provisoire et il se composait des anciens salons de réception de l?Impératrice qui furent libérés en 1860 avec l?aménagement des nouveaux salons sur l?ancienne terrasse. En mai 1870, le nouveau pavillon de Flore était encore en travaux de finition et on y installait au premier étage les futurs appartements du Prince impérial qui avait 14 ans.
Le rez-de-chaussée côté cour est affecté au salon d'attente, au salon des Officiers d'Ordonnances, puis venait l'ancien appartement du Prince impérial et de Miss Shaw, gouvernante du Prince, suivi du salon de Stuc, de la salle d'huissiers et du poste des Cent-garde donnant sur un vestibule péristyle desservant l'escalier de l'Habitation et qui servait d'entrée privée des souverains. Ce vestibule était adjacent au pavillon de Flore. Côté jardin, le rez-de-chaussée est occupé par les appartements de l'Empereur avec à partir du vestibule d'où part l'escalier de l'Impératrice, un salon d'huissier, le salon des Chambellans, la salle du Conseil desservie par un petit escalier à double rampe sur les jardins, le salon des Journaux, le cabinet de l'Empereur suivit d'un petit salon. Ensuite suivaient les appartements privés de l'Empereur : une salle de bains, un dégagement avec un escalier à vis conduisant aux appartements de l'Impératrice, un cabinet de toilette, la chambre à coucher, un salon privé et enfin trois pièces réservées aux secrétaires de l'Empereur suivies d'une antichambre pour huissiers donnant sur l'escalier de l'Habitation.
Notons que côté jardin, le rez-de-chaussée était surélevé d'environ 1m20 par rapport au parterre qui longe le palais et ce parterre accède au jardin par 3 marches basses.
La partie nord du corps principal du palais abritait au rez-de-chaussée, côté cour après le vestibule péristyle du Pavillon Central, la loge du Concierge du Palais puis les appartements du Premier Chambellan, le Comte Bacciochi. Ensuite se tenait l'appartement de l'Aumônier suivi de la sacristie de la chapelle. Au delà, nous étions au rez-de-chaussée de la salle des spectacles qui jouxtait le Pavillon de Marsan. Côté jardin, depuis le vestibule s'élève le grand escalier d'honneur, une pièce attenante à l'appartement du Premier Chambellan suivie de la salle à manger des Officiers de permanence au palais. Enfin, la Chapelle impériale se trouvait dans le pavillon du même nom, suivie d'une antichambre qui la séparait de la salle des spectacles.
Au premier étage côté jardin, s'achève le grand escalier. De là s?ouvrait la loge de la famille impériale donnant sur la nef de la Chapelle, avec ensuite une vaste antichambre puis le foyer du Théâtre. Ces deux dernières salles s'étalaient du jardin à la cour de même que la salle de spectacle qui jouxtait. Côté cour, à partir de la Salle des Maréchaux, la galerie de la Paix suivie de la salle des Gardes donnant sur le palier du grand escalier faisait suite à la galerie des Travées qui, longeant la Chapelle menait au foyer du théâtre puis à la salle des Spectacles. Cette dernière était polyvalente de part sa structure : on pouvait y donner des bals, y jouer une pièce de théâtre ou y donner un concert ou bien encore, y organiser un banquet.
Description de l?aile sud
Au sud du corps principal du palais, un pavillon d'angle, le pavillon de Flore, marquait la jonction avec en retour l'Aile du Bord de l'Eau qui venait d'être achevée. Cette aile sud du palais qui borde la Seine n'était pas encore intérieurement achevée. Elle était prévue pour abriter à partir du pavillon de Flore les nouveaux appartements du Prince impérial, les services de sa Maison et la Résidence réservée aux souverains étrangers en visite à Paris. Ensuite se tenait la salle des Etats dans le pavillon du même nom, destinée aux sessions communes du Sénat, du Corps Législatif et des grands corps de l'Etat. Au rez-de-chaussée de cet édifice se trouvaient les locaux de l'En-cas, les remises des voitures et une écurie pour le service du palais.
Description de l?aile nord
Au nord du corps principal le pavillon d'angle Marsan où loge le Duc de Bassano, Grand Chambellan de l'Empereur, avec sa femme la Duchesse, Dame d?Honneur de l?Impératrice. En retour, l'Aile Napoléon longe la rue de Rivoli jusqu'aux Guichets de Rohan. Dans cette partie qui suit Marsan existait une série d'appartements de hauts dignitaires dont faisaient partie les cousins maternels de l'Empereur, la famille Tascher de la Pagerie. La suite des locaux était affectée au Ministère de la Maison de l'Empereur qui gère la liste Civile, le Gouverneur des Tuileries y a ses appartements. A l'extrémité de l'aile Napoléon juste avant les guichets de Rohan se tenait la caserne du détachement de la Garde impériale.
Les services aux Tuileries
Le palais impérial des Tuileries était administré par un Gouverneur, un Préfet et un commandant militaire. La garde extérieure était assurée par un détachement de la Garde impériale dont les factionnaires montaient la garde à toutes les entrées. Celles ci étaient également surveillées discrètement par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur en tenue bourgeoise. A l'intérieur, des suisses et des huissiers assuraient la surveillance et les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice étaient sous la protection d'un détachement de 15 hommes de l'Escadron des Cent-Garde.
En ce qui concerne l'Intendance, le palais était pourvu de cuisines situées aux sous sol du pavillon de Flore et de l?aile abritant la galerie de Diane. Deux monte-charges assuraient la desserte entre les cuisines et la galerie de Diane. Une glacière et des magasins de vivres étaient installés sous la terrasse du Bord de l'Eau devant le pavillon de Flore.
Le second étage du palais était occupé, dans l'aile sud, de réserves d'atours où un monte charge les reliait aux appartements de l'Impératrice. Il y avait également deux logements de service. Au troisième étage et quatrième étage sous combles, il y avait une série de petits logements pour le personnel.
Eclairage et chauffage
Dans la cour du Carrousel et aux abords du palais, l'éclairage était assuré par des réverbères à gaz identiques à ceux que l'on voit de nos jours dans la Cour Napoléon et aux abords des Pavillons de Rohan, Lesdiguières et La Trémoille. A l'intérieur, l'éclairage se faisait dans les corridors, couloirs, dégagements et offices à l?aide de becs de gaz. Les salles étaient pourvues de candélabres et lampes à pétrole en complément des lustres classiques. Le chauffage était assuré par des cheminées mais aussi par des calorifères qui fournissaient de l'eau chaude.
Notons que l'électricité était déjà utilisée les jours de fêtes depuis 1867 pour éclairer la façade sur jardin et les jardins privés du Palais dont la partie réservée allait jusqu'au bassin rond des Tuileries.
Des hôtes illustres
Sous le Second Empire, les Tuileries recevront des visiteurs de marque dont certains seront logés au palais alors que les visites d'Etat ne sont pas encore aussi fréquentes que de nos jours. On retiendra les visites du Roi du Portugal, de la Reine Victoria et du Prince Albert, des souverains d'Italie, de Suède, de Belgique, du Roi de Prusse, de l'Empereur et de l'Impératrice d'Autriche, du roi de Bavière, du Tsar de Russie, des souverains d'Espagne, des souverains du Danemark, du Roi des Pays-Bas, du Sultan ottoman, du Vice Roi d'Egypte et même de la Reine des Comores.
La fin des Tuileries
Le palais impérial des Tuileries sera officiellement désaffecté le 10 septembre 1870 par un décret du Gouvernement Provisoire de la Défense Nationale présidé par le Général Trochu qui était le dernier Commandant Militaire du Palais...
Une partie du mobilier fut récupéré par le Mobilier National et les oeuvres d'art transportées dans les réserves du Louvre. Demeuré intact le palais fut laissé à la surveillance d'une dizaine de gardiens.
Mais à la fin de la Commune de Paris, une douzaine d'individus sous les ordres d'un dénommé Dardelle, à l'aide de pétrole, de goudron liquide, d'essence térébenthine et de poudre, incendièrent le palais le mardi 23 mai 1871 vers 7 heures du soir. L'incendie dura 48 heures et fut résorbé par les soldats du 26è bataillon de Chasseurs d'Afrique et par les Sapeur Pompiers de Paris le jeudi 25 mai. En vue d'une restauration qui était possible, les ruines demeurèrent en l'état durant onze ans. En 1882, la IIIè République promis la reconstruction ultérieure des Tuileries et décida la destruction des ruines qu'elle vendit pour la somme de 33 300 francs à un entrepreneur. Ce dernier entama la destruction en février 1883 et le 30 septembre 1883, une brèche béante s'ouvrait entre Flore et Marsan?
Hervé Secchi-James