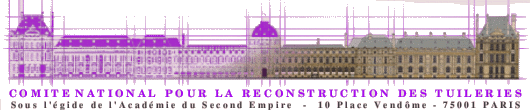
1831-1848
par Dominique Paoli, Historienne
Le roi Louis-Philippe ne s?installa aux Tuileries qu?en octobre 1831, plus d?une année après son accession au trône. Les somptueux travaux de sa principale résidence, le palais-royal, venaient à peine de se terminer et il rechignait à en partir. La politique lui ayant imposé d?habiter le palais où l?avaient précédé Napoléon, Louis XVIII et Charles X, il s?était mis, dès la fin de 1830, à bâtir une foule de projets. Tous ne seront pas réalisés, en raison de leur énorme coût, mais la part retenue sera suffisante pour améliorer considérablement les Tuileries et leur donner leur caractère quasi définitif.
La transformation majeure touche l?escalier d?honneur. Pour en comprendre l?importance, rappelons-nous que, sis entre le pavillon de Marsan et le pavillon de Flore, le palais est de forme longiligne et de faible profondeur, ce qui signifie que les pièces sont en double enfilade, l?une donnant sur la cour du carrousel, l?autre sur les jardins. Or l?escalier construit par Le Vau au XVIIe siècle, que l?on atteint au rez-de-chaussée par le vestibule du pavillon central, dit de l?horloge, coupe au premier l?enfilade du côté cour. A cet étage, il débouche sur le salon des maréchaux, juste au-dessus du vestibule précité, et dessert la suite des pièces allant vers le pavillon de Flore (côté Seine). De l?autre côté, la galerie qui mène au théâtre, contigu au pavillon de Marsan, ne peut s?atteindre directement : il faut descendre au rez-de-chaussée et gagner la partie nord par le sous-sol ou l?extérieur.
Décorateur dans l?âme, Louis-Philippe est également doué d?un grand sens pratique. Il demande donc à l?architecte Fontaine, qui a déjà travaillé aux Tuileries sous l?Empire, d?établir au premier étage une circulation continue d?un bout à l?autre du palais. Pour cela, Fontaine va démolir l?escalier de Le Vau et mettre cette partie du premier étage au niveau des autres pièces. On pourra donc aller du théâtre à la galerie de Diane en traversant une enfilade de salons d?environ 250 mètres, la plus longue d?Europe. La vaste pièce créée sera appelée salon de la paix lorsqu?on y transfèrera une statue de cette déesse, ?uvre de Chaudet, qui ornait l?antichambre de Louis XIV, depuis le règne de Napoléon.
Edifié parallèlement à l?ancien, côté jardin, le nouvel escalier provoquera « une admiration unanime ». Pour le construire, Fontaine supprime douze arcades ouvertes du rez-de-chaussée et la terrasse qui les couvre, alignant la façade sur celle du pavillon central. Conçu avec trois paliers successifs, il comprend une série de colonnes corinthiennes et, à l?étage, deux larges balcons, d?où l?on a, lors des réceptions de gala, une vue générale sur le cortège des invités. On y accède, en bas par le vestibule central, en haut par un petit salon séparant le salon de la paix de la galerie des travées, contiguë au théâtre.
Autre modification importante commandée par Louis-Philippe à Fontaine, la création de pièces d?habitation va entraîner une deuxième fois la suppression d?arcades ouvertes au rez-de-chaussée. Toujours du côté jardin ce sera le pendant du nouvel escalier, de l?autre côté du vestibule central, précédant les appartements privés du couple royal, seule partie possédant un couloir.
Vivre sur des jardins publics présente un grave inconvénient, les promeneurs pouvant venir jusqu?aux fenêtres. Seules quelques sentinelles assurent une protection des plus incertaines. Louis-Philippe, dès son arrivée aux Tuileries, a décidé de créer une terrasse ornée de fleurs et fermée par des grilles et des talus de gazon. Le tout sera protégé par un fossé. Cette mesure va provoquer de vives réactions sous forme de caricatures, de quolibets et même d?une pièce satirique intitulée « Le fossé des Tuileries ». Décidément le XIXe siècle français n?est une époque tendre ni pour les souverains ni pour leur résidence officielle, où bat pourtant le c?ur de la nation.