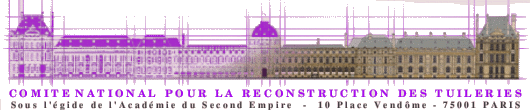
La réunion des Tuileries au Louvre (1849-1857)
Une ?uvre nationale
La réunion des Tuileries au Louvre a été décidée par une loi de la République, le 16 octobre 1849, et menée à bien par le Second Empire.
Un quartier de Paris s'élevait alors entre les deux palais. Et c'est aux Tuileries, que Louis-Napoléon, Président de la République, a signé le décret du 12 mars 1852 portant réunion des deux palais.
Les premiers mots du décret sont significatifs du souci de continuité française :
"Louis-Napoléon, Président de la République Française, considérant que la réunion du palais du Louvre à celui des Tuileries, commencée sous le règne de Louis XIV, et continuée par l'Empereur Napoléon, est une oeuvre nationale qu'il importe d'achever".
Après cinq ans de travaux intenses et le concours d'un nombre considérable d'hommes de l'art et d'artistes de toutes disciplines, Napoléon III inaugura le Nouveau Louvre le 14 août 1857.
Il prononça un discours tirant les enseignements de cette oeuvre nationale étendue sur trois siècles :
"Je me félicite avec vous de l'achèvement du Louvre. Je me félicite surtout des causes qui l'ont rendu possible. Ce sont, en effet, l'ordre, la stabilité rétablis et la prospérité toujours croissante du pays, qui m'ont permis de terminer cette oeuvre nationale. Je l'appelle ainsi puisque tous les gouvernements qui se sont succédé ont tenu à honneur de finir la demeure royale commencée par François 1er, embellie par Henri II.
D'où vient cette persévérance et même cette popularité pour l'exécution d'un palais ? C'est que le caractère d'un peuple se reflète dans ses institutions comme dans ses moeurs, dans les faits qui l'enthousiasment comme dans les monuments qui deviennent l'objet de son intérêt principal.
Or la France, monarchique depuis tant de siècles, qui voyait sans cesse dans le pouvoir central le représentant de sa grandeur et de sa nationalité, voulait que le demeure du Souverain fût digne du pays, et le meilleur moyen de répondre à ce sentiment était d'entourer cette demeure des chefs-d'oeuvre divers de l'intelligence humaine.
Au Moyen-âge, le roi habitait une forteresse hérissée de moyens de défense. Bientôt le progrès de la civilisation remplaça les créneaux et les armes de guerre par les produits des sciences, des lettres et des arts.
Aussi l'histoire des monuments a-t-elle sa philosophie comme l'histoire des faits.
De même qu'il est remarquable que sous le première révolution le comité de salut public ait continué à son insu l'oeuvre de Louis XI, de Richelieu, de Louis XIV, en portant le dernier coup à la féodalité et en poursuivant le système d'unité et de centralisation, but constant de la monarchie ; de même n'y a-t-il pas un grand enseignement à voir pour le Louvre la pensée de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de Napoléon, adoptée par le pouvoir éphémère de 1848 ?
L'un des premiers actes, en effet, du Gouvernement provisoire fut de décréter l'achèvement du palais de nos rois. Tant il est vrai qu'une nation puise dans ses antécédents, comme un individu dans son éducation, des idées que les passions du moment ne parviennent pas à détruire. Lorsqu'une impulsion morale est la conséquence de l'état social d'un pays, elle se transmet à travers les siècles et les formes diverses des gouvernements, jusqu'à ce qu'elle atteigne le but proposé.
Ainsi l'achèvement du Louvre, auquel je vous rends grâce d'avoir concouru avec tant de zèle et d'habileté, n'est pas le caprice d'un moment, c'est la réalisation d'un plan conçu pour la gloire et soutenu par l'instinct du pays pendant plus de trois cents ans".
(?uvres de Napoléon III, Paris 1869, Henri Plon et Amyot éditeurs, tome 5, pp.39)
L'apport considérable du Second Empire aux Tuileries et au Louvre
L'ensemble Louvre-Tuileries s'est développé sous le Second Empire en proportion des métamorphoses de Paris et de la France. Les Tuileries se sont trouvées au centre du redéploiement urbain de la capitale, comme l'explique très clairement M. Michel Carmona, Directeur de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne.
Le Guichet des Saints-Pères a été édifié, accès majestueux au palais des Tuileries, auquel fait suite l'arc de triomphe du Carrousel, seuil du parvis des Tuileries.
Face aux Tuileries, a été créé un rectangle parfait de 2 hectares, appelé Cour Napoléon III. C'est l'actuelle Cour Napoléon, où se trouve la pyramide. Une statue en pied de Napoléon III, toujours en place, prise dans le fronton du pavillon Denon, surplombe la pyramide. Deux plaques de marbre, prises dans la façade du pavillon central, dit de l'horloge, dont le péristyle relie la cour Napoléon à la cour carrée, mémorisent le rôle moteur du Second Empire dans l'histoire des deux palais :
A gauche du péristyle :
FRANCOIS 1er COMMENCE LE LOUVRE EN 1541
CATHERINE DE MEDICIS COMMENCE LES TUILERIES EN 1564
A droite du péristyle :
NAPOLEON III REUNIT LE LOUVRE AUX TUILERIES
1852 - 1857
Après la réunion des deux palais, ce fut au tour des Tuileries de se développer sous le Second Empire, selon le plan de restauration et d'agrandissement, approuvé par l'Empereur en 1862. Ce plan programme portait sur l'élément central (actuellement manquant), ainsi que sur l'aile nord le long de la rue de Rivoli avec le pavillon de Marsan, et l'aile sud le long des quais avec le pavillon de Flore.
Cette dernière, en mauvais état (elle avait plus de 250 ans), a été arasée et réédifiée. Il suffit de comparer ce qu'était le Pavillon de Flore de Henri IV et celui de Napoléon III pour évaluer les embellissements des Tuileries par Hector Lefuel.
Le rayonnement des Tuileries
C'est sous le Second Empire que les Tuileries connurent leur plus fort rayonnement. Tous les souverains d'Europe s'y sont rendus, empressés, en hommage à la France métamorphosée de Napoléon III. Le roi Guillaume de Prusse y fut logé au Pavillon de Marsan. "Les Tuileries, c'était la pompe des cérémonies officielles" écrira Augustin Filon, précepteur du Prince Impérial. Dans l'immense salle du théâtre, de près de 1.000 m2, dont la scène avait été démontée, un dîner d'apparat a été donné en juin 1867 en l'honneur du Tsar Alexandre II et du roi Guillaume de Prusse.
Alain Boumier
Président de l'Académie du Second Empire