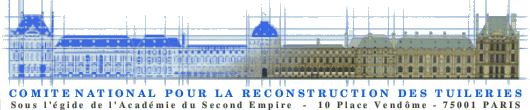
Voici un argument que l'on oppose au projet du Comité National pour la reconstruction des Tuileries : « vous allez créer un pastiche ».
Prenons du recul et demandons nous tout d?abord ce qu?est un pastiche. D?après le Grand Larousse, il s?agit d?une « ?uvre littéraire ou artistique dans laquelle on imite le style, la manière d?un écrivain, d?un artiste soit dans une intention de tromper, soit dans une intention satirique ».
Il est vrai, et tout le monde en conviendra, que ce n?est pas très joyeux de pasticher une ?uvre d?art, vu sous cet angle.
La reconstruction des Tuileries consiste simplement à restituer un morceau de patrimoine historique et architectural majeur. Certes, ce seront des artistes d?aujourd?hui qui tailleront et restitueront les colonnes, pilastres, frontons et statues mais ils le feront d?après d'après les ?uvres originales dont plusieurs ont été sauvegardées et dont nous avons les descriptions aux Archives Nationales. De plus, les personnes qui découvriront ou redécouvriront les Tuileries sauront que ce palais est une restitution puisqu?un tel projet ne pourra se faire sans leur soutien.
- Une copie sans âme ?
Bien sûr, on pourra toujours dire que ce n?est qu?une copie et que les évènements tant brillants que dramatiques qui se sont déroulés aux Tuileries n?ont pas eu lieu entre ces murs ou dans ces salons restitués. Cependant la plupart des monuments historiques ont vu de nombreuses restaurations qui ont été parfois très poussées.
Prenons l?exemple du Musée du Louvre et de la cour Napoléon. Le travail a été gigantesque et des parties entières de murs, des chapiteaux de colonnes et des frontons ont été resculptés à l?identique. Est-ce pour autant une simple copie sans âme ? Est-ce négatif ou même néfaste ?
Je pense sincèrement que l?on ne peut copier quelque chose qui n?existe plus.
Rebâtir les Tuileries, ce n?est pas copier les Tuileries, c?est leur rendre leur existence. J?admets que la copie conforme du château de Maisons-Laffite par un industriel chinois est tout à fait discutable car ce château existe déjà sur les bords de Seine et il possède un cadre et une histoire qui lui sont propres. Justement, les Tuileries avaient un cadre - avec d'un côté la cour du Carrousel et de l'autre le Jardin des Tuileries - mais également une très riche histoire où la France expérimenta tous les régimes. C?est pour cela que le projet est positif car il replace le chaînon manquant à sa place et en son dernier état connu sans pour autant être une copie sans âme.
- Bâtir de l?ancien ?
En outre, on reprochera peut-être au projet que ce n?est pas vraiment d?époque de rebâtir un ou plutôt des styles anciens et qu?une architecture sobre et moderne serait plus de notre temps.
Cela peut se concevoir mais quel autre état conviendrait mieux et réussirait à mieux s?insérer dans ce lieu que l?original ? La réponse semble bien se trouver dans la question. D?autant plus que pour l?harmonie de l?ensemble architectural la présence de bâtiments de styles voisins à ceux existants déjà ne peut qu?être bénéfique.
- Quelle valeur artistique pour les Tuileries rebâties ?
Peut-être dira-t-on alors : bâtir de l?ancien pour l?harmonie de l?ensemble n?a pas de valeur artistique. Certains seront sans doute de cet avis mais heureusement notre histoire architecturale est assez riche et variée pour nous démontrer qu?ils n?ont pas vraiment raison.
En effet, cette pratique de copier de l?ancien fut utilisée par les plus grands architectes français de leur temps et ce bien sûr pour l?harmonie architecturale.
- L?exemple des Tuileries sous Napoléon Ier.
Percier et Fontaine ont volontairement reproduit pour l?aile longeant la rue de Rivoli le style colossal que Jacques Androuet du Cerceau a utilisé deux siècles avant pour l?aile de la Grande Galerie du Louvre.

Partie restante de l?aile du début du XIXe siècle par Percier et Fontaine sur le modèle de l?ancienne galerie du Louvre de la fin du XVIe siècle signée Androuet du Cerceau. (Photo G. CRIEF)
- Même phénomène à Versailles.
En effet, Louis XVIII a fait détruire l?ancien pavillon Dufour de style Louis XIV pour le remplacer par le pavillon de style Louis XV que nous connaissons aujourd?hui afin qu?il soit en harmonie avec le pavillon de l?aile Gabriel qui lui fait pendant (le projet remontait déjà à Napoléon Ier). Est-ce pour autant que le pavillon Dufour recèle un intérêt moindre que le pavillon Gabriel ?
- La copie de styles par Le Vau
Enfin, voici le dernier exemple et peut être le plus symbolique car c?est un très grand architecte qui s?est adonné à la copie harmonieuse. Il s?agit de Louis Le Vau, l?architecte de Vaux-le-Vicomte, des Tuileries, de l?Institut, de Versailles, entre autres. Il commença par bâtir dans le style d?Androuet du Cerceau le pendant de l?aile sud des Tuileries (ou aile de Diane), l?aile de la salle des machines (c?est-à-dire la partie nord). Puis il bâtit dans le style Renaissance de Lescot et Lemercier la moitié des façades de la Cour Carrée considérée, à juste titre, comme une merveille de l?art français. Ainsi le plus bel ensemble de style Renaissance français serait un demi pastiche? mais pour les puristes uniquement. Enfin il finit par reproduire le style colossal du pavillon de Flore (pavillon sud des Tuileries) sur le nouveau pavillon de Marsan (pavillon nord) et commence une travée de l?aile qu?achèveront par la suite Percier et Fontaine sous Napoléon Ier.

Vue de l?aile est de la Cour Carrée du Louvre bâtie sous Louis XIV par Le Vau de 1659 à 1664 d?après le style renaissant de l?aile Henri II de Lescot (1546-1549). (Photo G. CRIEF)
Ainsi, il semble bien que le fait de copier un style ancien pour créer une entente avec ce qui existe déjà fut monnaie courante même pour les grands architectes. N?était-ce pas tout simplement respecter ce qui existait, respecter le passé ?
Personne ne reprochait hier, ni ne reproche de nos jours, à nos grands artistes français d?avoir bâti de l?ancien pour l?harmonie et pour le respect du passé. Alors pourquoi le reprocherait-on maintenant au projet de reconstruction des Tuileries ?
Guillaume CRIEF
Ecrit à Paris, le 18 juillet 2004
_______________