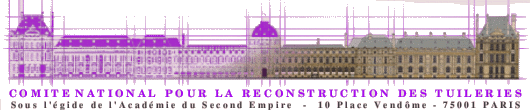
De l?incendie à l?amputation (1871-1882)
L?incendie du 23 mai 1871
Les Tuileries furent incendiées comme de nombreux autres bâtiments publics afin de couvrir la retraite vers l?Hôtel de Ville de certains éléments de la Commune.
En fin de journée, Bergeret, un élément extrême de la Commune, réunit aux Tuileries un conseil comprenant seulement une dizaine de personnes dont le gouverneur des Tuileries, Dardelle. Ce Comité restreint décida, contre l'avis de Dardelle, d?incendier le Palais des Tuileries. Ils firent donc apporter de grandes quantités d?essence et d?autres matières inflammables dans le péristyle du pavillon central puis se répartirent les tâches. Ils arrosèrent méticuleusement à l?aide de balais peintures, rideaux, parquets et lambris qui avaient vu tant d?évènements de l?Histoire de France. Seul Dardelle alla prévenir le nombreux personnel du Palais qui n?eurent que le temps de partir, et en milieu de soirée le feu fut allumé sur ordre de Bergeret en plusieurs endroits afin d?obtenir un embrasement généralisé.
L?incendie fut d?une violence et d?une durée incroyable tant il fut bien préparé et tant le feu trouva de bois à consumer. Le feu s?éteindra de lui-même deux jours plus tard.
Le constat
L?Assemblée Nationale et le Gouvernement ne surent que faire de cet embarrassent héritage que leur laissait la Commune. Que pouvait-on faire de ce palais incendié ?
La restauration des ruines était parfaitement possible puisque les murs étaient en bon état et quelques parties du Palais furent de plus épargnées par le feu comme le Grand Escalier. En fait, ces murs avaient peu soufferts de l?incendie car rien n?avait été fait pour l?éteindre et ainsi il n?y eut aucun choc thermique qui aurait irrémédiablement détruit la pierre. Evidemment les intérieurs de bois méticuleusement imbibés d?essence par les incendiaires furent des proies faciles pour les flammes qui firent effondrer les charpentes et les planchers du Palais. Les Grands Appartements furent les plus touchés par le feu alors que l?appartement privé de l?Empereur fut un peu plus épargné.
Une première destruction
Après les premières hésitations, il fut déjà décidé en 1873 de raser les deux ailes abritant au nord l?ancien théâtre et au sud la Galerie de Diane et une partie des anciens Appartements de l?Impératrice. Il s?agissait donc des deux ailes du style de Jacques Androuet du Cerceau que l?architecte français avait utilisé au sud et que Louis Le Vau avait copié au nord par soucis de cohérence. Outre la perte de ces deux parties du Palais, cette mesure ruinait le Grand Dessein en ouvrant la Cour du Carrousel sur le Jardin des Tuileries.
Pourquoi raser l?unique vestige restant de l?architecture d?origine d?Androuet du Cerceau ? La raison officielle fut le prétexte de la dangerosité des ruines de ces deux ailes qui auraient été au bord de l?effondrement cependant des photographies prises après l?incendie démentent cette thèse. Certes la corniche terminale devait être maintenue mais cela ne représentait nullement l?état général des ailes qui était encore bon.
Lefuel fut chargé de restaurer le Pavillon de Flore qu?il avait déjà reconstruit sous le Second Empire et qu?il habilla d?une façade au nord. Il obtint de raser le pavillon de Marsan, qui était encore dans le style de Le Vau copié d?Androuet du Cerceau, ainsi que l?aile Rivoli pour la reconstruire en partie dans le style qu?il avait déjà utilisé pour l?aile de Flore au sud.
Ainsi Lefuel pouvait continuer la réalisation du plan approuvé par l'Empereur en 1862, et qui avait été interrompue en 1869 faute de crédits.
Les projets de reconstruction
Il ne restait, après la première destruction, que la partie centrale du Palais, c?est-à-dire entre le pavillon de la Chapelle et le pavillon Bullant. Une restauration de cette partie centrale constituait le projet soutenu par le Gouvernement. Mais en parallèle, Lefuel, architecte du Louvre et des Tuileries, espérait obtenir des modifications du style de cette partie centrale. Il élabora plusieurs projets qui auraient certes ressemblé de loin à l?ancien palais mais modifiés pour s?accorder au nouveau Louvre.
Ce nouveau Palais des Tuileries aurait retrouvé sa fonction du XVIIIème siècle, c?est-à-dire un palais des arts puisqu?il aurait été aménagé pour abriter des galeries d?art moderne (de l?époque) qui manquaient cruellement.
Après la mort de Lefuel fin 1880, Charles Garnier lui succéda dans ses fonctions. Il proposa également trois projets de reconstruction des Tuileries.
Il y eut des dizaines d?autres projets d?architectes moins connus qui montraient l?enjeu de cette reconstruction.
La destruction finale
Il faut rappeler que le projet de restauration des ruines a été soutenu jusqu?en 1879, date à laquelle la nouvelle Assemblée prit un visage républicain plus radical envers les Tuileries. Une époque charnière puisque un autre ardent défenseur de la reconstruction, Viollet le Duc, meurt en 1879.
Le projet de restauration fut retiré par Antonin Proust, député du cercle de Gambetta, puis l?on réunit la Commission chargée du devenir des Tuileries qui fit plusieurs propositions très contradictoires. Peu de temps après, un projet de loi fut proposé tendant, dans un premier temps, à faire disparaître les ruines pour dégager l?espace et examiner ensuite les projets de reconstruction. Malgré une opposition du monde de l?art dont le brillant discours du baron Haussmann fut l?un des sommets, la Chambre des députés vota la démolition des ruines le 30 juillet 1879 mais le projet fut bloqué par le Sénat et renvoyé à la Commission. Celle-ci demanda alors à Garnier ses trois projets mais la question des ruines était déjà explicitement résolue puisque les projets de Garnier étaient des reconstructions et non des restaurations. Malheureusement Lefuel décédé ne pouvait plus défendre son projet et la question fut envoyée au Parlement.
Le dernier acte se joua lorsque Antonin Proust devint Ministre des Beaux-Arts. Il présenta alors une loi qui stipulait que l?important était de repartir sur de bonnes bases, que les ruines gênaient : il fallait donc les raser. Le projet de loi fut voté par la Chambre des députés le 21 mars 1882 à une écrasante majorité. Mais il fallait encore que le projet soit approuvé par le Sénat. C?est alors que Jules Ferry, alors Ministre de l?Instruction publique et des beaux-arts, plaida la cause de la destruction en promettant de reconstruire. Il réussit à obtenir le nombre de voix nécessaires et le Sénat vota les crédits d?arasement le 28 juin 1882. Ce jour là, le destin des ruines était scellé.