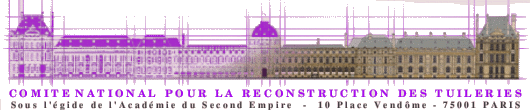
C?est ainsi qu?est désigné le grand projet des gouvernements de la France de Catherine de Médicis à Napoléon III. Celui-ci avait pour but de relier le château du Louvre en pleine transformation au nouveau palais des Tuileries afin de créer autour d?immenses cours, propices aux parades, une grandiose cité royale. Le projet se réalisa sur trois siècles de 1564 à 1857 et chaque régime que ce soit la Monarchie, les Empires ou la République, apporta sa pierre à l??uvre nationale, développant ainsi un immense panorama de l?Histoire de France à travers l?architecture classique monumentale.
Cette description du Grand Dessein se borne aux faits historiques c?est-à-dire aux bâtiments qui ont été réalisés et ne prendra pas en compte la grande quantité de projets non-réalisés qu?imaginèrent les architectes durant trois siècles.
Il y eut différents apports de chaque régime :
- Apports d?Henri IV
- Apport de Louis XIII
- Apports de Louis XIV
- Apport de Napoléon Ier
- Apport de Louis XVIII
- Engagement décisif de la Deuxième République
- Apports de Napoléon III
- Apport de la Troisième République et destruction des Tuileries
Apports de Henri IV
Un ancien projet des derniers Valois
On attribue généralement l?idée du Grand Dessein à Henri IV. Cependant ce désir de bâtir un immense quadrilatère remonterait à Catherine de Médicis. En tout cas, il est certain que c?est Henri IV qui débuta les premiers travaux du projet avec l?édification de la Grande Galerie reliant le Louvre aux Tuileries le long de la Seine.
Edification de la Grande Galerie
Une première tranche de travaux fut conduite par Louis Métezeau entre le Louvre et l?enceinte de Charles V, dans un beau style Renaissance dont nous pouvons encore apprécier les ornements. La seconde moitié de la Galerie était l??uvre de Jacques Androuet du Cerceau mais elle était construite dans un style plus monumental avec d?immenses pilastres corinthiens d?un seul jet du sol au toit. Ainsi avec cette présence de deux styles éminemment différents, on distinguait rapidement la partie intra-muros de la partie extra-muros.
Prolongation des Tuileries vers le sud
Le corps de bâtiments des Tuileries fut prolongé vers le sud par la construction de l?aile abritant la Petite Galerie entre le pavillon Bullant et un immense pavillon d?angle établissant la jonction entre Tuileries et Grande Galerie : le pavillon de Flore. Ces deux éléments étaient également des réalisations de Jacques Androuet du Cerceau et ils avaient le même style colossal que la partie occidentale de la Grande Galerie. La date de construction de cette jonction s?établit entre 1595 et 1610, c?est-à-dire durant l?ensemble du règne d?Henri IV.
Apport de Louis XIII
Amorçage du quadruplement de la cour du Louvre
En fait, l?apport de Louis XIII au projet de son père concerna uniquement le Louvre puisqu?il commença l?édification des bâtiments qui devait aboutir au quadruplement de la cour du Louvre. Ces travaux amorçaient la construction d?un autre côté de l?immense cour qui deviendra la Cour Napoléon.
L??uvre de Lemercier
C?est Lemercier qui fut chargé du projet. A partir de 1624, il construisit le pavillon du Louvre (aujourd?hui pavillon Sully) et l?aile faisant le pendant de l?aile Lescot. Cette aile reproduisait le style employé par Lescot pour plus d?unité. Enfin, une aile en retour d?équerre fut bâtie amorçant le côté nord de la cour cependant, on n?était déjà plus sous le règne de Louis XIII mais sous la régence d?Anne d?Autriche durant la minorité de Louis XIV. Là encore, un style proche de celui de Lescot fut choisi avec tout de même une composition originale de l?architecte pour le traitement plus classique du deuxième étage.
Apports de Louis XIV
Achèvement du quadruplement de la Cour Carrée
Louis XIV n?accordait pas vraiment d?attention au palais parisien du Louvre puisqu?il n?aimait guère Paris depuis les évènements de la Fronde. Cependant il s?attela, sous l?impulsion décisive de Colbert, d?achever le quadruplement de la Cour Carrée. Les travaux furent menés par Louis Le Vau de 1659 à 1664 et les façades sur cour respectaient scrupuleusement le modèle amorcé par Lemercier dix ans plus tôt.
Multiples transformations des Tuileries
En même temps Le Vau se chargea de d?édifier aux Tuileries le pavillon du Théâtre, l?aile abritant la Salle des Machines et le pavillon de Pomone. Le pavillon copiait le style du pavillon Bullant alors que l?ordre colossal de Jacques Androuet du Cerceau décorait la nouvelle aile et le nouveau pavillon. Ainsi Le Vau donnait une nécessaire symétrie à ce côté du quadrilatère.
C?est encore Le Vau qui réaménagea le corps central du palais des Tuileries de 1664 à 1667 afin de rehausser le bâtiment et de transformer le pavillon central qui fut agrandi et coiffé d?un dôme quadrangulaire.
La Colonnade et l?Aile du Midi
Le dernier chantier que lança Louis XIV fut la construction de la Colonnade du Louvre et de l?Aile du Midi de la Cour Carrée, côté Seine, mais ici, Le Vau fut associé à un autre architecte Perrault qui laissera son nom à cette ?uvre. Le style monumental et particulier des bâtiments construits est une création de Perrault qui fondait par la même occasion le classicisme français. Le chantier se déroula de 1667 à 1670 et ce fut le dernier que connut le Grand Dessein pendant longtemps puisqu?il fallut attendre 1806, soit 136 ans, pour que la grande ?uvre nationale continuât.
Apport de Napoléon Ier
Fermeture de la Cour du Carrousel au nord avec la construction de l?Aile Rohan
L?apport majeur du Premier Empire fut la construction par Percier et Fontaine de 1806 à 1811 de l?aile Rohan, le long de la nouvelle Rue de Rivoli. Le nouveau bâtiment s?étendait sur environ 150 m de long entre le pavillon de Marsan et l?actuel pavillon Rohan. Le style architectural utilisé côté cour du Carrousel était une copie de l??uvre qu?Androuet du Cerceau avait réalisée pour le Grande Galerie. Là encore, c?est le souci d?homogénéité et d?harmonie qui prima sur la créativité architecturale. Cependant, la façade de l?aile sur la Rue de Rivoli avait un style très militaire avec une sobriété rigoureuse et de nombreuses niches entre les fenêtres, abritant des statues en pied des grands soldats de l?Empire.
Un arc pour entrer triomphalement au palais impérial des Tuileries
L?Arc de Triomphe de Carrousel fut également bâti durant cette période, de 1806 à 1809. Il était désiré par l?Empereur afin que les troupes partant en guerre puissent défiler sous ses arches. Ainsi, le thème de la décoration est évidemment militaire avec des bas-reliefs des grandes victoires, des plaques de marbre commémorant les exploits de la Grande Armée et des statues de soldats.
Le rôle de l?arc était aussi de constituer une entrée triomphale pour le palais des Tuileries et d?amortir la discordance d?axe entre le pavillon Sully et le pavillon central des Tuileries. La chute de l?Empire en 1814 empêcha la continuation de l?immense projet que Percier et Fontaine avaient conçu pour achever le Grand Dessein.
Apport de Louis XVIII
Deux travées supplémentaires
En réalité, Fontaine réussit à ajouter deux travées de plus à l?Aile Rohan sous le règne de Louis XVIII. Cependant, les travaux furent très lents puisqu?ils s?étendirent de 1816 à 1824.
Engagement décisif de la Deuxième République
La République de nouveau installée désirait faire un coup d?éclat afin d?acquérir une certaine légitimité. De plus, le taux de chômage important dans les ateliers nationaux, entraînant une situation sociale explosive, incita fortement le gouvernement à lancer une politique de grands travaux.
Ainsi à l?unanimité, on décida que l?achèvement de la réunion du Louvre aux Tuileries serait une ?uvre nationale. En ce sens, un décret fut signé le 24 mars 1849 et une loi fut votée le 4 octobre de la même année pour préparer le terrain en autorisant le dégagement des espaces nécessaires.
C?est bien la Deuxième République qui engagea l?achèvement du Grand Dessein des Rois de France qu?elle avait repris en son nom.
C?est Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République française qui décréta le 12 mars 1852, après plusieurs concertations en Conseil des Ministres, l?achèvement de la réunion du Louvre aux Tuileries. Cette décision donnait enfin les moyens de réaliser le projet de Visconti, consistant à doubler les deux galeries sur une moitié de leur longueur afin de diminuer la perception du défaut de parallélisme. Ce projet fut repris par Lefuel à la mort de l?architecte mais il y apporta de nombreuses modifications.
Mais le Président de la République devint bientôt Empereur et c?est son règne que s?achèvera le Grand Dessein même si la République en était instigatrice.
Apports de Napoléon III
Achèvement du Grand Dessein
En effet, c?est sous le règne de Napoléon III que furent édifiés les bâtiments du Nouveau Louvre que nous connaissons encore de nos jours.
C?est Hector Lefuel, successeur du défunt Visconti, qui fut chargé de cette tâche de 1852 à 1857. Il réalisa cet énorme chantier avec une rapidité incroyable puisqu?il ne lui fallut que cinq ans pour bâtir l?ensemble de la Cour Napoléon et achever la partie nord sur la Rue de Rivoli, soit un quart du Grand Dessein. Ce Nouveau Louvre fut réalisé dans le style très éclectique de l?époque alliant symboles économiques et politiques, sous les regards des Hommes illustres de France. Même si de nos jours nous ne pourrions plus imaginer le Louvre sans ces bâtiments sur la Cour Napoléon, cette architecture néo-renaissance fut tout de suite décriée et ce jusqu'à très récemment.
Reconstruction de la partie occidentale de la Grande Galerie et du pavillon de Flore
Le pavillon de Flore donnait des signes de faiblesse structurelle due à de mauvaises fondations et ce problème se posait également pour la partie occidentale de la Grande Galerie. De plus, l?architecture d?ordre colossal de certaines parties des Tuileries contrastait avec l?architecture du Nouveau Louvre, c?est pourquoi Napoléon III et Lefuel décidèrent de raser ces parties pour édifier des bâtiments neufs plus en accord avec le Louvre. Le nouveau pavillon de Flore fut construit avec le style éclectique en vigueur. Côté Seine, Lefuel copia simplement l?architecture d?un grand raffinement qui fut exécutée par Métezeau, sous Henri IV, pour la partie orientale de la Grande Galerie. Côté cour, Lefuel construisit le grand pavillon des Sessions le long de la galerie avec une architecture semblable à celle du Nouveau Louvre, ainsi qu?une nouvelle aile doublée en largeur avec une architecture néo-renaissance s?inspirant de l?aile Lescot du Louvre. Enfin, de grands guichets furent percés afin de donner une entrée monumentale au complexe palatial enfin achevé.
En fait, Lefuel avait procédé aux mêmes transformations sur l?aile Rohan côté cour et de transformer les ailes latérales du palais des Tuileries (ailes abritant la Salle des Spectacles au nord et la Galerie de Diane au sud) à l?aide de placages néo-renaissance. Ainsi, l?intégralité des bâtiments sur la cour aurait été signée de son nom mais la chute du Second Empire en 1870 l?empêcha de réaliser son projet.
Apport de la Troisième République et destruction des Tuileries
Reconstruction du pavillon de Marsan et de l?aile Rohan
Après les évènements tragiques de la Commune qui aboutirent à l?incendie des Tuileries et de l?aile nord du Louvre, le nouveau gouvernement républicain chargea Lefuel de reconstruire le pavillon de Marsan sur le modèle de ce qu?il avait déjà réalisé au pavillon de Flore ainsi qu?une partie de l?aile Rohan. Ces travaux s?étalèrent de 1874 à 1880 mais le manque d?argent empêcha Lefuel de construire le pendant du pavillon des Sessions, qui devait abriter un théâtre, ainsi que les grands guichets au nord, semblables à ceux déjà construits au sud.
La destruction des Tuileries
Les Tuileries restèrent en ruine durant douze années. Mais dès 1874, en marge de la reconstruction du pavillon de Marsan, on avait déjà rasé les deux ailes latérales des Tuileries. La partie centrale entre pavillon de la Chapelle (ancien pavillon du théâtre) et pavillon Bullant resta en l?état.
Malgré un excellent état de conservation des ruines, la Troisième République préféra annihiler ce symbole du pouvoir des régimes déchus en occultant délibérément le rôle primordial des Tuileries dans l?histoire de la Première République.
Bien sûr, il était prévu de reconstruire un édifice qui rappellerait les proportions du palais disparu afin d?y installer un musée d?art moderne, mais l?instabilité politique perdura et ajourna toute décision. En effet sur ces douze années d?indécision, il ne fallut pas moins de trois présidences et dix-sept ministères pour détruire l??uvre nationale.
Destruction du Grand Dessein
Il n?est pas trop fort de parler de destruction du Grand Dessein pour deux raisons. Premièrement l?on a détruit la cause même qui avait donné naissance au Grand Dessein : le palais des Tuileries. Sans ce palais, le Grand Dessein n?a plus de sens. Deuxièmement, même si un bâtiment avait été construit à l?emplacement des Tuileries, il n?aurait en aucun cas former une cour fermée alors que c?était le but du Grand Dessein : former une vaste enceinte royale et artistique.
Pensée personnelle
La République pensait s?affirmer définitivement en arasant les vestiges parisiens de la Royauté alors que le palais avait accueilli la toute première République française. D?ailleurs, est-ce que la Première République détruisit Versailles ou les Tuileries pour affirmer son autorité ? Cependant même si la situation politique était encore tendue en 1883, personne ne saurait expliquer l?extrémité de cette mesure qui compte parmi les plus dommageables pour l?Histoire de France. Comment peut-on montrer si peu de respect envers l?Histoire de la Nation française ?
Certes, quelques éléments extrêmes de la Commune avaient déjà commencé l??uvre de destruction en incendiant délibérément et méticuleusement le palais pour qu?il n?en restât plus rien? mais la pierre ne brûle pas. C?est là encore une décision politique qui achèvera le macabre travail de destruction, qui ruinera trois siècles d?efforts au delà des régimes politiques toutes tendances confondues.
Maintenant que la République est définitivement installée, ne pourrait-on pas rendre à la Nation ce qui lui fut pris en reconstruisant pour Elle une vaste enceinte d?art où le palais des Tuileries, lieu primordial pour la compréhension de l?Histoire de la France moderne, retrouverait la place qui lui est due ? Il est certain que cela redonnerait son sens et son harmonie à cet ensemble architectural unique, malheureusement amputé aujourd?hui. Ainsi la restitution de cet ensemble dans toute sa plénitude est l?un des buts que s?est fixé le Comité National pour la Reconstruction des Tuileries.
Guillaume CRIEF
Elève-ingénieur des TPE